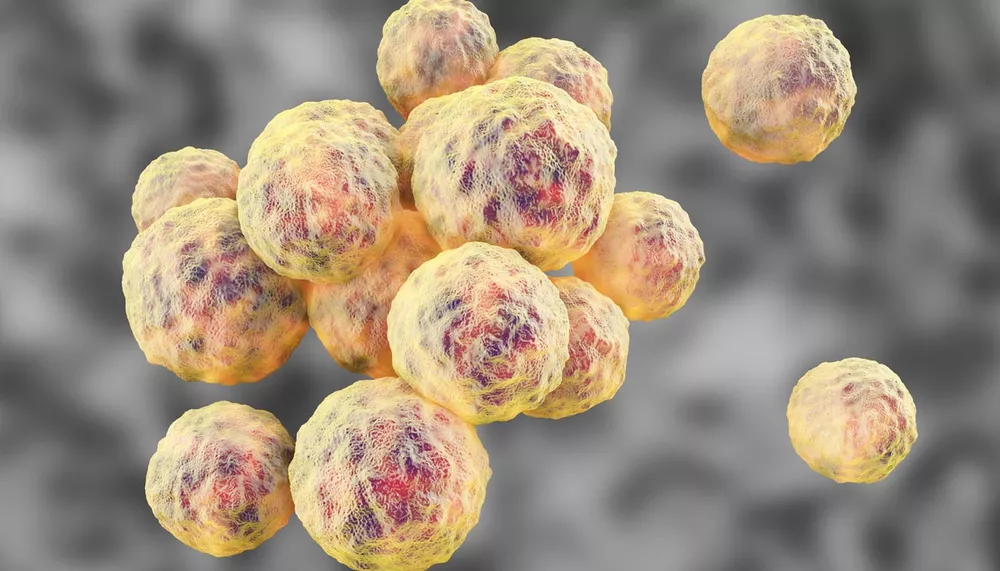
Pourquoi les tentatives de vaccin contre le staphylocoque doré ont-elles toutes échoué à ce jour ? Publiée dans la revue Cell Reports Medicine, une étude américaine pointe l’effet d’anticorps non vaccinaux, issus de premières rencontres avec la bactérie.
Aucun des vaccins testés contre le staphylocoque doré (S. aureus) n’a à ce jour porté de fruits, malgré une quinzaine d’essais de phase 2 et 3, et de nombreux résultats concluants chez l’animal (1). À l’origine de ce hiatus, le fait que l’homme et la souris de laboratoire n’entretiennent pas les mêmes relations avec cette bactérie.
Chez l’homme, le staphylocoque doré, lorsqu’il n’agit pas en pathogène, est fréquemment présent dans le nez et sur la peau. À l’âge de deux mois, environ 50 % des nourrissons sont déjà porteurs d’un staphylocoque doré, qu’ils continueront à héberger toute leur vie, très souvent sans heurt. En revanche, la souris, du fait de son confinement, est rarement exposée à cette bactérie.
Chez l’homme, ces premières rencontres avec S. aureus donnent lieu à la production d’anticorps dirigés contre plusieurs antigènes, en particulier ceux de la paroi bactérienne. Or ces anticorps s’avèrent non protecteurs contre S. aureus. Lors des essais de vaccination contre l’un de ces antigènes, les nouveaux anticorps (vaccinaux) subiront donc la compétition de ceux déjà présents, d’où une forte baisse d’efficacité protectrice.
Dans son étude, l’équipe de George Liu, pédiatre à l’University of California San Diego (UCSD), démontre que l’efficacité d’un vaccin dirigé contre S. aureus dépend bien de l’exposition antérieure à la bactérie (2). Lorsque les souris sont pré-exposées à S. aureus, le vaccin perd toute efficacité, de la même manière que chez l’homme. De même, l’administration aux souris d’anticorps humains dirigés contre le staphylocoque annihile tout effet vaccinal.
Est-ce à dire que la vaccination contre le staphylocoque doré est une cause perdue ? Pas certain : selon les chercheurs, il est possible de contourner cette interférence en ciblant d’autres antigènes. Plutôt que de viser des antigènes « dominants », tels ceux de la paroi bactérienne, les auteurs proposent de s’attaquer aux « sous-dominants », par exemple ceux des toxines bactériennes.
Selon Chih-Ming Tsai, co-auteur de l’étude et également chercheur à l’UCSD, « un pathogène présente divers antigènes auxquels le système immunitaire peut répondre, mais il existe une hiérarchie entre eux, certains étant dominants par rapport aux autres. La plupart des vaccins reposent sur des antigènes dominants, afin que la réponse immunitaire soit la plus forte. Chez S. aureus, il serait peut-être plus bénéfique de cibler des antigènes sous-dominants, qui engendrent une moindre réponse au premier contact ».
Dans leur étude, les chercheurs montrent en effet que, chez les souris pré-exposées au staphylocoque doré, un vaccin dirigé contre de tels antigènes sous-dominants est aussi efficace que chez des souris non exposées à la bactérie. Explication : ces antigènes suscitent moins d’anticorps de la part de la souris lors d’une première exposition -d’où l’absence d’interférence lors de la vaccination.
Selon George Liu, « le staphylocoque doré vit avec l’homme depuis longtemps, il a appris à agir parfois en symbionte, d’autres fois en pathogène. S’il s’agit de développer des vaccins efficaces contre cette bactérie, nous devons comprendre et déjouer les stratégies auxquelles elle recourt pour maintenir cet équilibre ».
Article rédigé par Romain Loury et initialement publié sur MediQuality.
Références
- Development of a vaccine against Staphylococcus aureus invasive infections: Evidence based on human immunity, genetics and bacterial evasion mechanisms, Miller et al., FEMS Microbiol Rev. 2020 Jan 1;44(1):123-153. doi: 10.1093/femsre/fuz030
- The characteristics of pre-existing humoral imprint determine efficacy of S. aureus vaccines and support alternative vaccine approaches, Caldera et al., Cell Rep Med. 2024 Jan 16;5(1):101360. doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101360
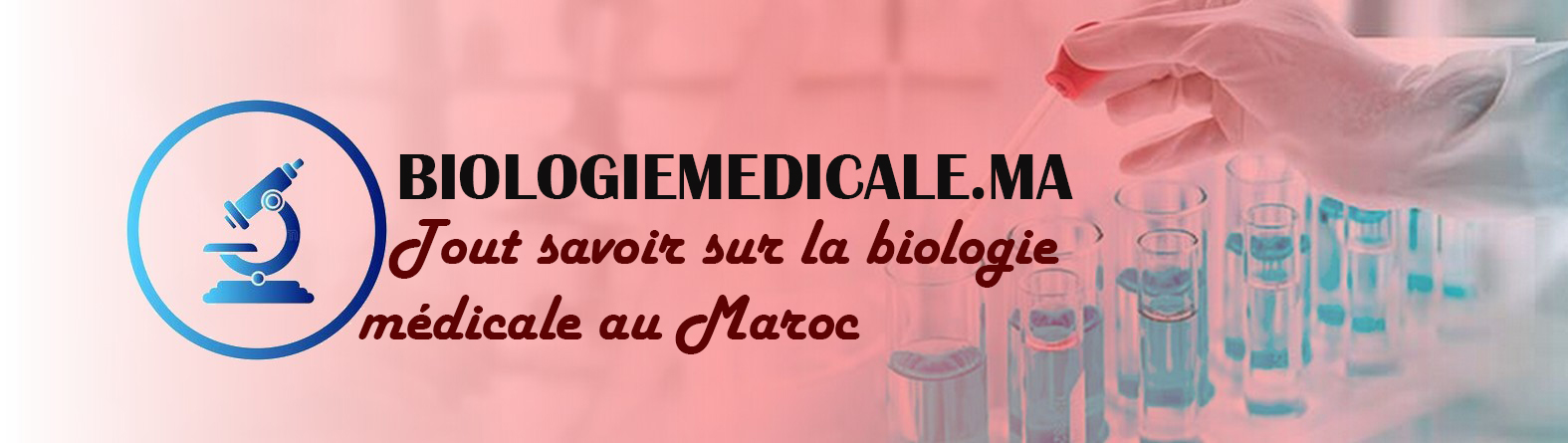 Biologiemedicale.ma Tout savoir sur la biologie médicale au maroc
Biologiemedicale.ma Tout savoir sur la biologie médicale au maroc